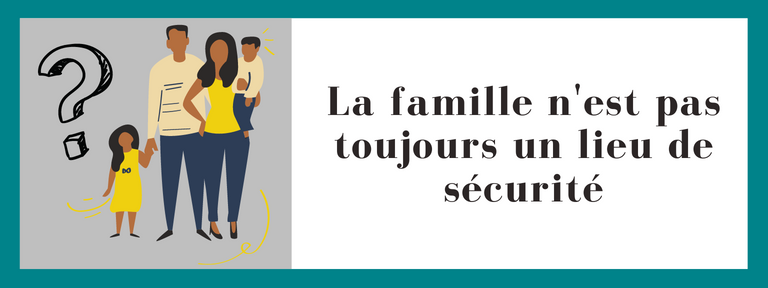Sommaire :
- et de la loi comme preuve de l’institutionnalisation de la violence et des rapports de domination
- I. Le langage comme outil de représentation et surtout de dissimulation des rapports de domination : l’absence de l’agresseur et l’invisibilisation de la famille comme lieu des violences
- II. Le mythe de la famille comme zone de protection s’effondre pour révéler le lieu de violences graves et/ou ordinaires systémiques, mais encore impossible à reconnaitre par l’ensemble de la société.
- III. La loi, preuve et actrice dans le temps de l’institutionnalisation des rapports de dominations (et donc de violences) des hommes sur les femmes et les enfants : quand la peur de ses parents vaut consentement au mariage
- IV. L’ambiguïté de la loi comme preuve de l’institutionnalisation des rapports de dominations (donc des violences) sur les enfants et au sein du couple :
- V. La loi comme preuve (très récente) de l’institutionnalisation des rapports de domination sans aucune ambiguïté en matière de violence sexuelle sur mineur : l’exemple de la Loi Billon du 21 avril 2021
- 1 – L’introduction d’une clause « Roméo et Juliette » permet l’inversion de la charge de la preuve par la domination de fait lié à l’âge des personnes concernées : preuve de l’institutionnalisation de rapports de domination
- 2 – L’introduction dans la loi d’une différence d’âge comme seuil de déclenchement du principe protecteur de « non consentement », jusqu’à 18 ans en cas de violences sexuelles intrafamilliales (inceste), et seulement jusqu’à 15 ans pour les autres violences sexuelles : une inégalité de traitement des agressions sexuelles sur mineur en fonction de leur âge, exemple d’institutionnalisation par la loi de rapports de domination.
Et de la loi comme preuve de l’institutionnalisation de la violence et des rapports de domination
Par Edith.
Ah ce mythe de la famille comme lieu chaleureux, bienveillant et protecteur… Et si on en parlait ?
« L’ordre public ne s’arrête pas aux portes de la maison » dit le Juge Edouard Durand (interview de C.Kouchner par Brut). Il ajoute que le tiers est indispensable dans ces situations car c’est « celui qui nomme l’écart entre la loi et le réel ». Cela peut être l’école, le/la médecin, l’éducateur-trice, le/la psychologue avec l’école comme lieu de repérage important. Pourquoi pas la mère ? Pourquoi n’est-elle pas un tiers comme les autres ?
Le langage, tout autant que la loi nous montrent aujourd’hui que nous sommes encore loin d’une culture de la protection. Cependant, à l’échelle du temps des droits humains, nous vivons en matière de prise en considération et protection de l’enfant, une évolution fondamentale de l’humanité, vers une humanité encore grandie, une humanité plus réelle.
« Lire » le langage et lire la loi comme expression du vivre ensemble nous permet de mesurer les avancées parcourues mais aussi toutes celles qu’il reste à obtenir et que nous avons la possibilité de faire advenir ici et maintenant. Nous avons tous les moyens de continuer à avancer vers cette humanité qui demande obstinément la fin radicale de toutes les violences faites aux enfants, et en particulier les violences sexuelles dont l’inceste.
Les violences sexuelles dont l’inceste en tant que tabou sociétal sont un fléau incarnant une société qui se ment à elle-même. La famille est bien un lieu de violence interdite pourtant par la Loi. La société entière entretient le mythe de la famille, lieu de protection, alors que la famille est le premier lieu d’apprentissage des rapports de domination, sous couvert d’éducation.
Nous (ré)affirmons qu’il est possible de décider que tout type de violence est à proscrire. Il existe aujourd’hui suffisamment de connaissances pour s’éduquer à éviter les rapports de forces et de domination. La coopération et la collaboration sont des manières de se relier aux autres non seulement efficaces tout en préservant le lien entre les personnes mais aussi une alternative tout aussi efficace à la violence pour apprendre à vivre ensemble.
Tout ceci est possible sans même besoin de changer la loi, mais en avons-nous la volonté collectivement ?
Pour que ce changement advienne, il faut d’abord reconnaitre la violence, ses causes et les lieux de son exercice. Il faut ensuite avoir le courage de la nommer, pour pouvoir enfin la traiter, et choisir de faire complètement autrement.
Les travaux lancés par l’Eglise dans le cadre de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (CIASE), sur les enfants ainsi que la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIVIISE) sont une grande avancée pour notre humanité.
Le langage est la seule porte d’entrée pour que les violences soient nommées mais correctement, pour pouvoir être stoppées. La transformation habituelle d’une violence conjugale en conflit conjugal ou parental fait disparaitre de fait l’origine de la violence. C’est un des mécanismes d’invisibilisation de la violence intrafamiliale le plus puissant au sein des institutions en charge de la protection des personnes.
La loi est d’ailleurs encore la preuve de l’institutionnalisation des rapports de domination hérités depuis des siècles.
Il suffit de vouloir voir, pour le voir, puis le croire. Il est surtout possible de changer cet état de fait. A nous de voir si on veut changer ce mythe de la famille.

I. Le langage comme outil de représentation et surtout de dissimulation des rapports de domination : l’absence de l’agresseur et l’invisibilisation de la famille comme lieu des violences
Les chiffres des violences faites aux femmes (âgées de 18 à 75 ans) selon le site du gouvernement « arrêtons les violences.gouv.fr » indiquent qu’elles sont largement majoritaires au sein du couple, donc au sein du socle de la Famille.
- Sur la période 2011-2018, les femmes âgées de 18 à 75 ans victimes de violences physiques et/ou sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint , donc au cœur de la famille, est estimé à 213 000 femmes en moyenne par an. A noter que ce chiffre ne couvre pas l’ensemble des violences au sein du couple car ne rend pas compte des violences verbales, psychologiques, économiques ou administratives mais seulement physiques. Or nous savons que des violences psychologiques peuvent être toutes aussi destructrices et en particulier car invisibles à l’œil nu. Encore une fois, il faut vouloir voir, pour le voir et le croire.
- En moyenne les femmes âgées de 18 à 75 ans victimes de viols ou tentatives de viols sont estimées à 94 000 femmes, Dans 91% des cas, elles connaissent l’agresseur et dans 43% des situations, l’agresseur est le conjoint ou l’ex conjoint et dans 32% des situations une personne très proche (cf.Enquête Cadre de Vie et sécurité de 2018 de l’INSEE sur commande du ministère de l’intérieur).
- Depuis 2017 jusqu’en novembre 2021, 496 femmes sont mortes en France sous les coups de leur conjoint ou ex conjoint.
Avant de passer à un examen de la loi en ce qu’elle reflète très justement l’état de la volonté politique dominante (au sens de majoritaire), il peut être utile de faire quelques remarques sur la manière de nommer ces nouvelles statistiques par le gouvernement reprises par les institutions dans leur ensemble :
- C’est l’expression « violences faites aux femmes » qui a été retenue par les pouvoirs publics pour commencer à reconnaitre le problème. Et il faut saluer cette nouveauté qui consiste en particulier pour les pouvoirs publics à effectuer des enquêtes pour recenser les actes relatifs à ces violences. La première enquête date de 2000 dont les résultats ont été publiés en 2003 .C’était donc hier et c’est une évolution majeure. Grâce à ce travail, au regard des chiffres cités plus haut, maintenant nous savons. Nous savons que la violence existe même si elle est cachée au sein des familles dont la première brique est le couple.
Mais le choix de cette expression interroge : la formulation très neutre liée à l’emploi du verbe faire, « faites aux femmes», semble aller dans le sens d’une banalisation de la chose en soi au même titre que l’on fait la cuisine, on fait le ménage, on fait la guerre, on fait l’amour, les violences sont faites aux femmes. Dans le même ordre d’idée, sa formulation sous la forme passive semble donner la priorité à une objectification de la femme. François Héritier a bien mis en évidence que le choix des mots ou concepts attribués dans différentes langues donne une idée des valeurs qui la sous-tendent. Les mots ou formulations renvoient au féminin ou au masculin en fonction de ce qui est valorisé chez l’un ou l’autre. Le langage est culturel, dit notre société et n’est pas l’émanation d’une simple observation du réel. Il suffit de comparer les cultures pour s’apercevoir qu’en Inde le passif est un attribut masculin car valorisé dans cette partie du monde. La puissance vient de la maitrise de soi-même et sur les choses, tandis qu’en Europe, le passif, est plutôt hiérarchisé du côté du féminin. L’actif étant l’apanage de l’homme.
Alors qui sont les agresseurs? Ne pourrait-il pas aussi être utile de parler de violences faites par des hommes sur des femmes (et enfants)? De la violence des pères sur les mères ? De la violence des époux sur les épouses ? Des compagnons sur les compagnes ? F.Héritier relevait cependant que par cette expression « Violences faites aux femmes », il ne faisait aucun doute dans l’esprit de la population que les agresseurs étaient des hommes. » (Conférence à la Maison des Métallos- Femmes victimes de violences dans la sphère publique, le 25 novembre 2014).
Aujourd’hui le site vie-publique, au demeurant très utile pour objectiver les violences subies par les femmes, termine son propos avec un grand titre « les réponses sociétales apportées aux femmes ». Ne pourrait-on pas également voir écrit « Les réponses sociétales apportées pour empêcher les hommes d’agresser » ?
- Puis il est à noter que l’expression « violence au sein du couple » a aussi été retenue. Mais qu’est-ce que le couple, sinon le noyau de base, le socle de l’institution autour de laquelle notre société s’est construite à savoir « la famille » ? Pourquoi ne parler que du couple et non de la famille ? Pourquoi ne pas parler de famille ? Cela permettrait de mettre en lien directement les relations intrafamilliales dans leur ensemble par rapport aux conséquences qu’elles peuvent avoir en particulier sur les enfants témoins et donc de toute façon victimes.
La France a clairement choisi dans ses réflexions liées aux politiques en faveur des femmes d’utiliser le vecteur de l’égalité professionnelle en laissant de côté les éléments liés à la sphère familiale, contrairement au Québec par exemple. En effet, le Québec a investi le sujet en lien avec la famille à travers la promotion de l’autonomie économique des femmes comme clé de l’émancipation selon Anne Revillard.
Alors, ne pas parler de ces agressions au sein de la famille interroge, comme ne pas parler des agresseurs interroge également.
Au regard des statistiques énoncées et en citant simplement Adèle Haenel dans son interview du 3 novembre 2019 à M. Christope Ruggia sur Médiapart, nous savons désormais que les violeurs, les violents et les agresseurs sont bien au cœur de notre entourage : « Ce ne « sont pas des monstres. Ce sont nos pères, nos frères, nos amis… ». Il est rappelé une fois encore que 91% des femmes les connaissent dont la majorité exercent leur violence au sein de leur propre famille (47% sont les compagnons ou ex compagnons) et donc souvent de manière cachée, protégés par le « secret » obtenu par l’emprise ou la menace.
Alors pourquoi ce choix ? Que ce choix de mots dit-il des idées qui sous-tendent ces choix de présentation et représentation de ces violences ? Que les femmes sont des victimes donc renvoyant à un imaginaire de soumission, de faiblesse, d’incapacité à se défendre ? Que les hommes n’y sont pour rien car ne sont jamais nommés ?
Alors, oui, nommer les victimes pour visibiliser le phénomène est essentiel pour qu’elles puissent être enfin reconnues, et accompagnées dignement. Mais ne pas nommer les agresseurs et ce qu’ils sont, montre que notre société n’est pas prête à pointer les réels responsables. Ne pas les désigner, cela revient aussi à ne pas s’attaquer sérieusement au traitement de leurs violences et par conséquent à ne pas penser non plus comment il pourrait être mis fin à cette violence, et enfin pouvoir viser son éradication. Cela revient aussi à nier la responsabilité de la famille pour protéger le socle de notre société.
II. Le mythe de la famille comme zone de protection s’effondre pour révéler le lieu de violences graves et/ou ordinaires systémiques, mais encore impossible à reconnaitre par l’ensemble de la société.
Selon l’Observatoire national de la protection de l’enfant (ONPE), le nombre d’infanticides en France depuis 2016 est systématiquement majoritairement commis au sein des familles : Depuis 2016, chaque année il y a eu 68, puis 67, 80, puis 53 et enfin 49 enfants tuées au sein de leur famille entendue au sens large soit père, mère, beaux-parents, grands-parents, oncle, tante, membres de la fratrie). Il faut également noter que sur chacune de ses années, c’est toujours plus de 60% d’enfants qui ont moins de 5 ans.
C’est sans parler du fait qu’il est aujourd’hui reconnu, que les violences au sein des familles (physiques et/ou sexuelles) concernent 213 000 de femmes victimes au sein du couple donc de la famille en France (cf.ci-dessus), et qu’il est enfin reconnu depuis le décret du 23 novembre 2021 que les enfants sont des victimes à part entière de cette violence.
Si l’on prend le chiffre du Haut-Commissariat à l’Egalité (HCE) dans son rapport du 9 juin 2021, ce sont 398 000 enfants co-victimes de violences conjugales.
Concernant les violences sexuelles sur les enfants, ce sont 160 000 enfants agressés sexuellement par an. D’après le rapport intermédiaire de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) auprès de plus de 10 000 personnes, l’agresseur est un membre de la famille à 84% pour les femmes et à 64% pour les hommes. Par extrapolation des chiffres de la CIIVISE, l’association « Sous le regard d’Hestia » calcule que sur la totalité de ces violences sexuelles, 44% sont des violences incestueuses soit 70 000 enfants par an dont 22 000 enfants sont incestés (agressés sexuellement) par le père. Il y aurait donc un 1/3 des incestes qui seraient du fait du père. Cela représente donc 31% du total des incestes.
Alors pourquoi ces chiffres ne sont pas plus connus, diffusés et/ou suffisants pour considérer qu’il s’agit là d’un vrai fléau, d’un crime de masse ?
Alice Miller pointe du doigt dans la Connaissance interdite « l’aveuglement de la société par la peur de mettre en cause ses parents ». Cette peur permet la répétition de la violence des parents sur les enfants. Pourtant, reconnaitre la violence potentielle des parents peut permettre à un enfant d’envisager une possible reconstruction. Ce faisant, cela permettrait que ne soit pas répété ces crimes de génération en génération.
Il s’agirait donc là de toucher à des mécanismes liés à des croyances très fortement ancrées sur le respect total de l’enfant vis-à-vis du parent, sur l’impossibilité d’un parent de mal faire, sur la nécessité d’une éducation comme il faut etc. Elle complète tout de même cette pensée en pointant les règles de notre société qui indiquent en pratique que « seuls les pédophiles sans enfants sont punis par la société. Les enfants étant considérés comme propriété des parents, à l’intérieur de la famille, le comportement le plus anormal, le plus absurde, le plus pervers peut sans entraves détruire la vie des autres, sans que personne ne le remarque ». (p.71)
Or, à ce stade, l’aveuglement de la société semble très cohérent avec la tolérance mutique des innombrables violences perpétrées impunément dans le cadre familial. Une hypothèse, provocatrice – quoi que…- pourrait quand même être formulée : moins qu’un aveuglement de la société, n’y aurait-il pas une réelle intention du législateur (de nos députés et sénateurs) de conserver un corpus de règles visant à «faciliter » les violences sexuelles sur les enfants et encore plus au sein du « huis-clos des familles » ?
A.Miller mentionne également les travaux d’Elisabeth Trube-Becket, médecin légiste qui en 1987, affirme que pour un cas de violence sexuelle perpétrée sur un enfant signalé, c’est 50 cas qui seront tus. Un autre fait mis en avant est que des millions de professionnels du soin (médecins, psychiatres, éducateurs…) s’occupent de traiter les conséquences liées à ces violences sexuelles « sans s’en rendre compte, ou sans avoir le droit de dire de quoi il s’agit ». Nous resterons aujourd’hui sur les chiffres officiels, donc connus des violences faites sur les enfants.
III. La loi, preuve et actrice dans le temps de l’institutionnalisation des rapports de dominations (et donc de violences) des hommes sur les femmes et les enfants : quand la peur de ses parents vaut consentement au mariage
Alors pour mesurer à la fois le chemin parcouru et celui qu’il reste encore à parcourir, il peut être utile d’illustrer d’où l’on vient en matière du droit de la famille et en particulier par rapport à l’évolution du mariage comme institutionnalisation de la domination de l’homme sur la femme, et plus largement, le symbole de rapport de domination consacrés comme fondement du vivre ensemble dans les familles.
C’est l’article 63 du code civil, chapitre III, des actes de mariage, qui explique les conditions dans lesquelles le mariage peut-être déclaré nul. Il dispose : « …la célébration du mariage est subordonnée à l’audition commune des futurs époux, sauf en cas d’impossibilité ou s’il apparait, au vue des pièces fournies, que cette audition n’est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180 ». Cf.article 63 alinéa 2.
Il faut donc se référer à l’article 146 qui pose sainement le principe suivant : « Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement » selon une loi en date de 1803. Il pourrait d’ailleurs être noté, que dans ce cas, la notion d’explication du consentement n’a pas eu l’air de faire énormément débat, contrairement aux cas de dénonciations de viols que nous vivons depuis le mouvement METOO.
Puis nous découvrons l’article 180 du code civil modifié par une loi de 2006 précise: « Il ne peut pas y avoir de mariage sans consentement libre des deux époux, l’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant constitue un cas de nullité du mariage ».
La « crainte révérencielle » est un « sentiment d’obéissance, de respect et de crainte inspiré par une personne du fait de l’autorité qui est la sienne. » qui a été pensée comme étant le fait des parents au premier chef, ou tout autre figure d’autorité au sein de la famille.
Lire cela, peut nous plonger dans ce double mouvement qui pousserait à se dire d’abord : « Mais c’est la moindre des choses, heureusement… ! ». Et en même temps, se dire que cela a dû être écrit dans la Loi et en 2006, il y a donc seulement une 20aine d’année montre de manière très claire qu’il s’agit d’un fait récent. Il s’agit bien d’un choix nouveau que de mettre un terme à l’institutionnalisation d’un rapport de domination évident « d’un ascendant sur son enfant ». Si cela a été possible en 2006, il est heureux de se laisser aller à penser que cela peut aussi l’être en 2022.
Alors la raison de mon optimisme, est à la fois dérisoire mais aussi puissante. Cette disposition de l’article 180, nous indique en quatre dates comment les choses ont changées :
- Le mariage forcé a été aboli par la loi de 1803 selon l’article 180.
- Mais le même code Civil 1804, a maintenu son article 1114 dans le chapitre « Droit des contrats » qui dispose : « La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat (Code civil, 1804, art. 1114) »
Pour qui dispose d’un tempérament logique, si au sein d’un même code civil, un article indique un impossible (en l’espèce l’article 180 en droit du Mariage, qui interdit le mariage forcé en 1804 et donc posé le principe du consentement obligatoire), pourquoi un autre article continue à le permettre en sous-entendant que la « crainte révérentielle » donc la peur de ses parents ne suffit pas à mettre fin à un contrat ? En droit des contrats on apprend donc que la crainte de ses propres parents ne permet pas d’annuler un contrat signé dans ces circonstances, donc que faire dans le cas d’un contrat de mariage ?
Il semble assez clair que le code civil contient donc des articles pouvant conduire à dire tout et son contraire. On peut se reporter à l’analyse de Mme Rude-Antoine qui indique que l’article 1114 aurait été conçu pour assurer le contournement justement de la règle énoncée en Droit du mariage, même si d’autres juristes s’en défendent. Ceux-ci indiquent que justement, le mariage aurait été exclu de l’article 1114. . Or la seule chose qu’il convient de garder en tête, est que la Loi sur ce point entretient de manière certaine la confusion, et de fait, entretient le doute sur le fait que la Loi « dit vraiment » ce qu’elle permet, en l’espèce la contrainte des parents sur les enfants en matière de mariage.
La crainte révérentielle se place donc du côté de la violence légitime « permise par la loi donc la société, donc nos députés, sénateurs, donc les citoyens français », ou autrement dit de la « violence autorisée » donc de fait « encouragée » par tous et chacun.
Ceci est une bonne introduction à la lecture de la loi comme permettant finalement «tout et son contraire ».
L’avantage est que cela donne de claires indications à qui veut vraiment les lire, de l’inégalité et de l’injustice entretenues par la loi elle-même dès qu’il s’agit de toucher aux règles régissant la famille, et en particulier lorsque les règles organisent les rapports de domination de manière tout à fait asymétrique.
- C’est donc en 1975 (mise en vigueur un an plus tard le 1er juillet 1976) qu’est instituée la possibilité de dénoncer un mariage qui aurait été conclu sans le consentement libre des époux ou de l’un d’entre eux. C’est une énorme avancée qu’il faut donc saluer. Elle ne date donc d’il y a 47 ans.
- Puis en 2006, le législateur modifie cette disposition par le rajout « y compris par crainte révérencielle envers un ascendant constitue un cas de nullité du mariage ». C’était donc certainement encore nécessaire pour qu’il fût utile de devoir préciser que la pression d’un ascendant ne pourrait désormais plus opérer comme moteur ou raison du mariage, contrairement à la volonté de l’enfant (qu’il soit adulte ou encore enfant). Cette évolution témoigne une fois encore au sein de nos sociétés de rapports de domination persistants malgré des avancées salutaires pour l’égalité. C’était il y a 16 ans.
- Et enfin, c’est en 2016, que l’article 1114 du code civil au titre du « Droit des contrats », en vigueur depuis 1804, a été réformé soit 10 ans après l’article 180. En matière de contrat c’est donc une révolution qui est opérée puisque la légitimation de la « crainte révérencielle » a été totalement enlevée et remplacée par la formule suivante : « L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. ». Il est aussi à noter, en passant, que si cette formulation était retenue dans tous les cas d’agressions sexuelles et viols, l’équilibre entre individus serait rétabli d’un trait de plume. C’était il y 6 ans.
Pourquoi cette formulation valable en droit des contrats, ne pourrait-elle pas être tout simplement transposée en droit pénal ? Il semblerait que cette piste à explorer pourrait permettre de traiter simplement le problème à la racine : savoir s’il y a eu ou non consentement est forcément déclaratif, et « à défaut de consentement explicite » comme dans un contrat, « il y a seulement invitation à entrer en négociation ». Si le droit des contrats le permet, pourquoi le droit pénal ne le pourrait-il pas ?
Mais pour en revenir à cette asynchronie temporelle dans la modification de la loi, que doit-on conclure de ces constats ou tout au moins quelles questions peuvent alors se poser ?
La crainte et la peur d’un parent étaient encore jusqu’en 2006 en droit de la famille, puis 2016 en droit des contrats, considérées comme légitimes dans l’organisation de la vie de leurs enfants, et le tout consacré dans le même code civil droit donc par notre société. C’était donc hier.
En effet, alors même que « la crainte révérencielle (d’un enfant vis-à-vis d’un ascendant) » est bannie tardivement en matière de mariage (2006) considérée comme insuffisante pour emporter nullité du mariage, puis finalement encore plus tardivement en 2016 dans le code civil au chapitre « droit des contrats ». On pourrait se demander si le maintien de « la crainte révérencielle comme insuffisante pour faire annuler un contrat » jusqu’en 2016 aurait pu avoir des conséquences indirectes sur l’application de l’article 180 en matière de mariage ?
En d’autres termes, en matière de droit des contrats et donc en matière économique, « la crainte révérencielle » était légitime jusqu’en 2016 n’emportant donc pas vice du consentement des enfants par rapports à leur parent. Cela a-t-il pu avoir un effet sur l’absence de dénonciation d’abus au civil en matière de mariage, par crainte de représailles économiques dans le cadre de contrats à visées financières conclus par ailleurs entre les personnes qui se sont mariées, et/ou leurs parents respectifs ? Cette hypothèse ne semble pas pouvoir être écartée d’autorité. Faire le lien entre les deux types de liens, lien du mariage et liens économiques via le droit des contrats, pourrait être révélateur du maintien de la violence par le biais économique. En tous cas, il est permis de se poser la question.
En tout état de cause, deux possibilités se dégagent : soit le droit est incohérent, soit il y a une cohérence. Mais dans les deux cas, comprendre à qui cela profite donne des clés pour traduire l’état des valeurs de notre société
Quelque soit le résultat de cette réflexion, il est déjà certain qu’elle n’est pas en faveur de l’enfant, puisque la domination des parents (oui) sur l’enfant (adulte ou enfant) est restée légitime jusqu’en 2016, il y a à peine 6 ans en matière de mariage, donc au cœur du droit de la famille.
IV. L’ambiguïté de la loi comme preuve de l’institutionnalisation des rapports de dominations (donc des violences) sur les enfants et au sein du couple :
Aujourd’hui, malgré l’instauration d’une majorité à 18 ans, les mineurs peuvent encore se marier.
Mais que cela veut –il dire des valeurs portées par notre société ?
Sortir du débat proprement juridique permet de voir l’essentiel des valeurs que nous portons collectivement par le biais de la loi, expression du vivre ensemble que nous souhaitons.
1 – Quand la contradiction intrinsèque de la Loi interdit mais permet en même temps aussi le mariage des mineurs
Comme tout le monde le sait, la majorité est à 18 ans. Le code civil consacre dans son article 144 le principe suivant : « Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus. »
Les discussions qui se sont tenues en 2021 concernant la majorité sexuelle rabaissée à 13 ans, puis heureusement (et encore) à 15 ans sont l’illustration la plus manifeste d’une culture du viol par précisément ceux qui font la loi, donc nous tous, puisque nous élisons nos députés. Pourquoi discuter d’un consentement sexuel différent de la majorité de 18 ans?
De manière surprenante, notre même code civil actuel, quelques articles plus loin, dans son article 148 dispose que : « Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement. »
Encore une fois, par simple logique :
- pourquoi le législateur maintient-il à quelques articles de différence l’opposé du principe de droit général consacré c’est-à-dire qu’un mineur peut se marier ?
- Pourquoi, s’il s’agit d’une exception n’est-elle pas regroupée par simple esprit pratique sous le même numéro d’article ? Se pourrait-il que cette simple question pratique puisse nous donner des indices sur le degré de clarté et de transparence des valeurs à l’œuvre maintenues sciemment dans la loi ?
Admettons maintenant qu’une réponse raisonnable puisse être apportée à ces deux questions Quand bien même le maintien du « tout et son contraire » aurait sa logique à savoir « seuls peuvent se marier les personnes ayant atteint l’âge de la majorité, soit 18 ans », et « les mineurs ne peuvent se marier qu’avec le consentement d’au moins un de leurs parents et du Procureur de la République», la question la plus importante à se poser reste : en quoi y aurait-il urgence aujourd’hui à se marier en étant mineur ?
Avec l’allongement de la durée de vie, le nombre moyen de partenaires par personne qui a augmenté. Dans quel cas, l’urgence d’une union via le mariage justifierait qu’un mineur ne puisse pas tranquillement attendre d’avoir 18 ans ?
Or, si l’on rapporte le nombre d’agresseurs à leur genre, 96% des agresseurs sont des hommes dans les cas de violences sexuelles sur enfants. Faut-il alors regarder aussi la proportion d’hommes qui font nos lois ?
2 – Quand la domination d’un seul parent emporte consentement de tous.
Il convient également à ce stade de s’arrêter sur le reste des valeurs sous-tendues par l’article 148.
Ce dernier maintient le consentement des parents sur une décision individuelle de leur enfant mineur. Le rapport de « domination » appelé de manière acceptable « responsabilité » est donc clairement la règle alors même que ce qui est en jeu pour le mineur est bien uniquement sa vie propre. Et de manière encore plus étonnante, il est écrit qu’en cas de désaccord entre les parents, cela emporte consentement tout simplement. Il est clair qu’avec cette disposition, l’accord et la prise en compte positive de l’avis de chacun des parents n’est pas ce qui est cherché. Ce qui semble être le plus important est bien le consentement d’un des deux « parents» sur l’enfant qui l’emporte plutôt qu’un accord entre les parents.
Autrement dit il s’agit simplement de préférer le rapport de « domination » d’un parent au moins vis-à-vis de son enfant et non d’encourager un accord entre parents. Il y a ici la preuve que c’est la conservation du rapport de domination dans cette triangulaire père/mère et enfant qui semble être la chose la plus importante pour le législateur (donc nos députés, nos sénateurs, nos représentants).
Cette domination prime par rapport à la valorisation d’un accord commun entre les parents pour pouvoir faire advenir ce consentement. Et s’il on veut vraiment voir ce qui est à l’œuvre : au-delà de la preuve que la domination d’un adulte sur l’enfant est préférée, cet article de loi montre clairement également les racines de la domination conjugale : celui qui souhaite donc décider pour son enfant mineur qu’il doit se marier, l’emporte sur le conjoint qui ne le souhaite pas. Il s’agit donc ici d’une double soumission pour le conjoint qui ne le souhaite pas : non seulement il ne souhaite pas voir son enfant mineur marié, mais en plus son propre consentement est également nié, puisque la décision omnipotente d’un consentement unilatéral de l’un l’emporte sur l’autre. Si l’on veut incarner un peu plus le mécanisme : un parent qui souhaite protéger son enfant d’un mariage alors qu’il est mineur, échouera à le protéger de la décision de l’autre qui le souhaite. La violence de la domination est donc institutionnalisée dans notre loi.
En conclusion, l’absurdité de la loi aujourd’hui, apparait une nouvelle fois en défaveur des mineurs, donc des enfants. La loi apprend la domination des uns par les autres et continue à l’encourage au sein du couple comme vis-à-vis des enfants.

V. La loi comme preuve (très récente) de l’institutionnalisation des rapports de domination sans aucune ambiguïté en matière de violence sexuelle sur mineur : l’exemple de la Loi Billon du 21 avril 2021
Même, s’il faut saluer certaines avancées de la Loi du 21 avril 2021 visant à « protéger les mineurs des crimes et de l’inceste », il n’en reste pas moins qu’elle continue à conserver les mécanismes de dominations en incluant des exceptions et des différences de traitement des mineurs victimes de violences sexuelles.
1 – L’introduction d’une clause « Roméo et Juliette » permet l’inversion de la charge de la preuve par la domination de fait lié à l’âge des personnes concernées : preuve de l’institutionnalisation de rapports de domination
L’argument mis en avant par le Ministre de la Justice, M.Dupont-Moretti pour la clause de Roméo et Juliette afin soit-disant de ne pas pénaliser des rapports consentis pour la personne qui passera de 17 à 18 ans avec un enfant qui passera de 13 à 14 ans ou 14 à 15 ans est bien léger.
Pour rappel, la loi a intégré une exception au principe pourtant enfin protecteur de « non-consentement d’un mineur de moins de 15 ans et de moins de 18 ans en cas d’inceste» en cas de relations sexuelles avec un adulte. Or, un écart maximum de 5 ans entre deux mineurs ou jeunes adultes a été introduit dans la Loi pour que le seuil de non consentement soit aboli, contrairement au principe posé par la même Loi du 21 avril. Cette exception est consacrée dans l’article 222-23-1 du code pénal.
Une fois encore, la loi arrive à dire donc « tout et son contraire » au motif d’exception dont les justifications sont plus que discutables.
Or une chose ne peut pas être discutable en l’espèce : cette exception dite « Roméo et Juliette » permet d’autoriser un rapport de domination de fait, par la différence d’âge, en inversant la charge de la preuve la faisant peser sur la victime et non plus sur l’agresseur désigné. Elle profite directement aux jeunes les plus âgés par rapport aux plus jeunes, dans le cadre d’une relation aysmétrique et donc de domination de fait liée la différence d’âge.
Il est peut-être utile de rappeler ici, que si les rapports sont consentis, il n’y aura pas de problème. Alors à qui profite cette exception ? De quelle société nous parle-t–elle ? Quel seuil de violences sexuelles considérons-nous comme acceptable pour nos enfants ?
Trois types questions doivent être posées à ceux qui ont le pouvoir de faire autrement, de penser autrement, à moins que cela ne leur profite peut-être directement ou indirectement. Ces questions s’adressent :
- A tous les députés et sénateurs qui représentent aussi les futurs citoyens que sont les enfants ainsi que tous les magistrats qui ont en responsabilité d’assurer la protection de l’enfance et de manière générale la sécurité aussi au sein de notre société :
- Au Ministère de la Justice,
- A la Première Ministre,
- Au Président de la République,
- A qui cela profite ? L’article 222-23-1 du code pénal oblige donc les jeunes personnes de 14, 15, 16, 17 ans à prouver leur non-consentement si elles sont violées par des jeunes adultes de 19, 20, 21 et 22 ans. Cela profite donc simplement à des jeunes agresseurs, dont la conscience de leurs actes sera fraîchement légalement reconnue avec l’acquisition de leur majorité à 18 ans.
- Qu’est-ce que cela dit de notre acceptation qu’un jeune adulte puisse en matière sexuelle finalement savoir qu’il peut faire toutes les expériences qu’il souhaite sur des jeunes personnes à partir de 14 ans, puisque la preuve d’un éventuel crime ou délit ne leur incombera pas ? La charge de la preuve donc de la culpabilité reposera sur qui ? Quel message cela donne aux jeunes adultes vis-à-vis de la responsabilité de leurs actes sur plus petit que soi ?
- Enfin, qui peut donner une raison pour laquelle un jeune adulte de 18 à 22 ans, ne peut pas faire d’expérience de relations sexuelles avec ses pairs en toute légalité mais se tourne plus volontiers vers plus petit que lui ? Et plus encore, pourquoi la Loi (et donc nos députés, nos sénateurs et donc les citoyens français), a-t-elle autorisé cette exception ?
Sans présumer de la réponse de chacun des responsables de notre Etat français, bien que certains se soient déjà largement exprimés (ce qui facilite la compréhension de leur intérêt personnel ou celui de leurs pairs), une conjoncture sera posée : notre loi institutionnalise à dessein, les rapports de domination par l’abus de pouvoir, par l’emprise que contient en elle-même la différence d’âge au détriment d’un apprentissage sain du consentement.
Faire de la majorité légale de 18 ans, le seuil commun de déclenchement de tout principe de non consentement pourrait être si simple, si logique, si protecteur, si humain. Cela permettrait simplement de laisser le temps aux enfants mineurs de se construire autour du consentement mutuel, plutôt qu’autour de permissions implicites d’exercer un rapport de domination et de violences sexuelles sur les plus petits.
En effet, pour illustrer cette permission implicite, il faut revenir au « chapitre I. Le langage comme outil de représentation et surtout de dissimulation des rapports de domination » et relire l’article de loi concernée , soit l’Article 222-23-1 du Code de procédure pénale : « Hors le cas prévu à l’article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans ».
La rédaction suivante, qui revient au même, permet de rendre parfaitement explicite, la permission implicite :
« Hors le cas prévu à l’article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur mais seulement si la différence d’âge est égale ou supérieure à 5 ans à l’âge du mineur.
En effet, tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans et plus ou commis sur l’auteur par le mineur est autorisé lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans. Dans ces cas, tout mineur de 14 à 17 ans ayant été l’objet de violences sexuelles de la part de majeurs de 18 à 22 ans, devront prouver leur non-consentement et donc prouver qu’il a eu viol ou agression sexuelle. Ceci est valable contrairement à tous les autres jeunes de 14 à 17 ans qui seront violés ou agressés sexuellement par une personne ayant 6 ans et plus que la victime, qui n’auront pas à prouver leur non-consentement».
Voilà donc explicitement ce que la loi Billon telle qu’elle est écrite veut dire implicitement. Il s’agit ici du même mécanisme décrit ci-dessous : à savoir l’introduction d’une exception à un principe général dans la loi permettant l’apprentissage non seulement de l’inégalité de traitement entre mineurs, mais aussi donc de rapports de domination sous couvert de consentement présupposé. La Loi présume bien du consentement de mineurs à de possibles agressions sexuelles par plus âgés qu’eux dans la limite de 5 ans d’écart d’âge. La loi permet tout simplement l’autorisation légale de la domination des plus âgés sur les plus jeunes.
La loi continue à dire « tout et son contraire ».
2 – L’introduction dans la loi d’une différence d’âge comme seuil de déclenchement du principe protecteur de « non consentement », jusqu’à 18 ans en cas de violences sexuelles intrafamilliales (inceste), et seulement jusqu’à 15 ans pour les autres violences sexuelles : une inégalité de traitement des agressions sexuelles sur mineur en fonction de leur âge, exemple d’institutionnalisation par la loi de rapports de domination.
Alors, dans le même état d’esprit : à qui sert l’abaissement du seuil présumé de non-consentement à 15 ans, par ailleurs mis en cas d’inceste à 18 ans ? La loi donne un signe positif vis-à-vis des abus perpétrés au sein de la famille, et c’est tant mieux, mais dans un autre sens donne encore une autorisation plus large aux pédocriminels non incestueux (hors de la famille).
Cette inégalité de traitement instaurée entre des enfants de 15 et de 16/17 ans selon que leurs agressions sexuelles se passent au sein de la famille ou non, doit également interroger sur le message que cela envoie à nos enfants de manière générale. Il ne faudrait pas que cette « avancée » concernant la reconnaissance de l’inceste s’arrête là.
En guise de conclusion tout à fait provisoire, et pour les députés, sénateurs, pour le gouvernement, pour le Ministre de la Justice, pour le Président de la République, encore deux questions simples :
1. Qui pourrait donner une seule raison pour laquelle, un enfant devrait se marier mineur et ne pourrait pas attendre d’avoir 18 ans ?
2. Qui pourrait donner une seule raison pour laquelle, une agression sexuelle/viol sur mineur serait moins grave pour un enfant de 15, 16 et 17 ans, en cas d’agressions sexuelles et viol par une personne hors de la famille, que sur un enfant de 15,16, 17 ans au sein de la famille (cas d’inceste)?
Nous pouvons faire le choix de changer, vers plus de protection des enfants, vers moins de domination, vers plus de respect, donc vers encore plus d’humanité.
APPEL A ACTIONS DANS LE TEMPS : Pour tous les professionnels (médecins, psychologues, psychiatres, éducateurs, avocats, magistrats etc…) et/ou citoyens qui souhaitent participer activement à ce changement de société, vous pouvez écrire à l’adresse suivante pour plus d’informations : edith@protegerlenfant.fr